|
|
 |
.
|
ACTUALITE...
40ème ANNIVERSAIRE DU TRAITE
DE L'ELYSEE
22/01/1963 - 22/01/2003
. |
|
LES QUARANTE ANS DU TRAITÉ DE L'ÉLYSÉE
UNE RELECTURE DE " SOCIÉTÉ CIVILE " |
Par
le Professeur INGO KOLBOOM, Professeur à l'Université
de Dresde, membre du Haut Conseil culturel franco-allemand et membre
du comité scientifique du Forum franco-allemand.
Maintenant que
les invités d'honneur sont rentrés chez eux, les discours et les écrits
sur "l'amitié franco-allemande" se font à nouveau plus rares. Le quotidien
nous rattrape, ce même quotidien qui, aux dires du Président fédéral
Johannes Rau à l'occasion de son allocution solennelle prononcée au
Château de Bellevue le 23 janvier dernier, serait en Allemagne profondément
empreint de la France : "Aucun pays n'est aussi présent en Allemagne
que la France : dans la conscience des personnes et dans leurs intérêts,
dans leurs connaissances et leurs préférences. La coopération franco-allemande
est devenue quotidienne au meilleur sens du mot".
.
Celui qui prend cet énoncé au pied de la lettre voudrait bien
savoir comment on s'y est pris pour mesurer la "conscience",
les "intérêts", les "connaissances" et les "préférences" de
la population allemande, de la Sarre à l'Oder-Neisse, pour pouvoir
ainsi tirer un si beau constat, avec lequel on enjolive par
ailleurs encore bien d'autres discours. |
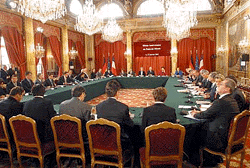
22.01.2003
- Conseil des ministres franco-allemand
© Ministère des Affaires Etrangères / F. de la
Mure |
Si l'on prend pour exemple des données quantifiables telles que les
habitudes de lecture et de télévision, les sorties au théâtre et au
cinéma, les voyages à l'étranger, les connaissances linguistiques,
la culture culinaire, etc...., le quotidien allemand se révèle alors
empreint d'une multitude de pays et de cultures, mais il ne s'agit
pas toujours pour autant de la France. En ce qui concerne les intérêts,
les connaissances et les préférences, d'autres périodes de l'histoire
allemande s'avèrent nettement plus " francophiles ", seulement ce
furent là des périodes pendant lesquelles la coopération politique
était beaucoup moins au goût du jour qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Afin de mieux illustrer cette "trivialité", le Président fédéral mentionne
les deux exemples de la chaîne de télévision "ARTE" et de la "Brigade
franco-allemande". Si l'on peut discuter longuement à propos du degré
de connaissance de la brigade auprès du public, la citer pour exemple
de la présence française au sein de notre quotidien relève d'une pensée
téméraire ; il est des contrées en Allemagne où le corps germano-hollandais
pourrait être encore mieux connu. Tout dépend donc du lieu à partir
duquel on choisit d'observer. Et pour ce qui est de la chaîne de télévision
ARTE, louée à l'excès dans tous les discours, articles et déclarations
comme véritable joyaux de la coopération franco-allemande, elle se
révèle en fait rien de moins qu'un couteau à double tranchants: les
quelques un pour cent des foyers allemands qui sélectionnent ARTE
ne devraient pas, en toute bonne foi, être appelés à représenter la
conscience quotidienne des téléspectateurs allemands dans leur ensemble.
Dans ces conditions, les allocutions solennelles franco-allemandes
relèvent aujourd'hui de l'usage d'une rhétorique politique que, de
toute façon, plus personne ne prend au sérieux, mais qui doit tout
de même donner à tous les partis concernés l'impression de vivre dans
"le meilleur des mondes" franco-allemands. Et gare à celui qui ose
rappeler que jamais depuis le XVIIIe siècle le français ne fut si
peu parlé et compris par les couches instruites de la société allemande
qu'il ne l'est à ce jour. Une "étude PISA franco-allemande" dresserait
pour sûr à nos deux pays et cultures un bien piètre bulletin de notes.
Si dans la Déclaration commune du Président Chirac et du Chancelier
Schröder prononcée le 22 janvier de cette année, "une meilleure
connaissance mutuelle de nos sociétés et de nos cultures"se retrouve
explicitement identifiée comme condition essentielle à l'élaboration
d'une "coopération renforcée entre la France et l'Allemagne",
alors il y a vraiment lieu de se réjouir du fait que la coopération
politique soit davantage dirigée par les intérêts de la "real-politique"
que par le niveau réel de connaissance mutuelle. Ceci s'applique tout
autant à notre propre pays. Dans cette veine, le Chancelier nous livre
une preuve supplémentaire des mauvais résultats de l'Allemagne à l'échelle
de l'étude PISA, choisissant expressément, au cours de son allocution
dans la Galerie des glaces du Château de Versailles le 22 janvier
dernier, le bien francophile roi Louis II de Bavière en tant que témoin
tragique de l'humiliation française, au moment de la proclamation
impériale de Versailles le 18 janvier 1871. En réalité absent lors
de la proclamation impériale, ce même Louis, qui fut à l'époque âprement
critiqué par les cercles nationalistes allemands en raison de sa répulsion
avouée envers l'Empire allemand et ses représentants, pouvait fort
difficilement être l'auteur de ce que lui attribue le Chancelier :
"(…) c'est le même Louis II qui porta la tragédie à son comble
: il ne vint qu'une seule fois à Versailles et ceci à dessein pour
infliger un camouflet à la France. C'est ici précisément, dans la
Galerie des glaces, qu'il couronna Guillaume Ier Empereur d'Allemagne".
.
| Toutefois
la rhétorique commémorative franco-allemande ne s'arrête pas
qu'à ces tentatives plus ou moins réussies d'emprunter des citations
pédagogiques à l'histoire. Elle s'affirme plus encore dans l'annonce
d'initiatives toujours plus neuves les unes que les autres.
Mais à y regarder de plus près, il saute aux yeux qu'on nous
ressert trop souvent du vieux vin dans une nouvelle outre. Lors
de la Déclaration commune de Jacques Chirac et de Gerhardt Schröder,
notre "coopération sans précédent" se voit illustrée
en quarante-trois articles et stimulée pour l'avenir. Les déclarations
d'intention se suivent littéralement les unes les autres. Le
fait est que dans les systèmes d'éducation allemand et français,
le bilinguisme (i.e. le français et l'allemand respectivement
placés sur un pied d'égalité avec l'anglais) est devenu un luxe
au sens pur. |

Le Professeur Ingo Kolboom
http://www.frankophonie.de
|
Par conséquent, il apparaît plus que suspect que ces deux États
précisément prétendent vouloir se porter garants du "pluralisme
linguistique dans les institutions de l'Union" (Article
12) et de "la diversité des langues" (article 15). Des
pays comme la Finlande, les Pays-bas ou le Luxembourg pourraient
prétendre à cette politique européenne du pluralisme linguistique
avec beaucoup plus de légitimité, puisqu'ils en sont déjà les
véritables représentants crédibles dans l'enceinte de leurs
propres frontières.
La volonté affichée des deux gouvernements "d'encourager
les jeunes de nos deux pays à considérer la France et l'Allemagne
comme un cadre unique pour l'accomplissement de leurs études
et l'exercice de leur profession" (Article 17) est, de son
côté, aussi pieuse que leur résolution à "souligner l'importance
de garantir la présence dans le paysage audiovisuel français
et allemand d'au moins une chaîne du pays partenaire et d'encourager
la réalisation et la diffusion de programmes communs par les
organismes de radiodiffusion et de télévision des deux pays"
(Article 21). Ces deux objectifs prennent pour acquis l'existence
d'un espace culturel et linguistique homogène et fonctionnel,
à la réalisation duquel les conditions nécessaires manquent
pourtant de plus en plus cruellement à l'appel. À la vérité,
la proportion réelle de jeunes (tous types d'institutions scolaires
confondus) qui ont la possibilité ou éprouvent le désir d'apprendre
la langue du pays partenaire va toujours décroissante. De moins
en moins de gens sont en mesure de comprendre le contenu linguistique
et culturel d'une chaîne de télévision du pays voisin. Pour
cette raison, la disposition de la majorité à sacrifier à cette
fin la diffusion d'une autre chaîne en langue maternelle est
en déclin constant.
Évidemment il sied bien d'encourager "l'ouverture européenne
de la chaîne culturelle ARTE, tout en conservant son identité
franco-allemande" (Article 21). Mais ne serait-il pas plus
pertinent de s'assurer qu'une proportion plus importante que
les quelques un pour cent actuels de la population allemande
puisse s'intéresser à ARTE, et que cette chaîne puisse également
être reçue en France en langue allemande ? Il persiste des régions
en Allemagne où le mot ARTE est totalement étranger, tout simplement
parce qu'ARTE ne peut y être capté sur les réseaux câblés locaux.
Le Haut Conseil culturel franco-allemand (qui n'est évoqué dans
aucun des discours officiels commémorant le quarantième anniversaire)
revendique depuis de nombreuses années une multitude de mesures
concrètes ; il n'a jamais rencontré d'écho. En revanche sa vielle
proposition de doter ARTE d'un programme franco-allemand pour
les enfants et les jeunes, dans le but à tout le moins d'encourager
chez ce groupe d'âge l'intérêt pour la langue et la culture
du pays voisin à l'extérieur du cadre scolaire, s'est vue bêtement
contrecarrée : la chaîne nationale pour enfants déjà diffusée
en Allemagne (" Kika ") a gagné le statut de programme pour
la journée entière ; et dans plusieurs régions, ce développement
se fit au détriment du temps d'émission de la chaîne ARTE.
Dans la tentative d'armer la Déclaration commune de nouvelles
initiatives et de signes de réussite, on ne trouve strictement
aucun renvoi à l'élargissement de la coopération franco-allemande
à la Pologne sous la forme du "Triangle de Weimar", inauguré
il y a dix ans. C'était compter avec la mémoire courte des médias,
qui devaient bien sûr tout oublier de cette initiative, cette
fois pourtant de portée réellement historique. D'ailleurs, il
n'en est fait mention dans aucun des autres discours. Par contre
l'annonce de la création d'un institut culturel conjoint et
d'ambassades communes à Moscou ne devait pas manquer au rendez-vous.
Les archives sont bourrées de telles déclarations d'intention.
Il y a déjà bien des années, on nous promettait la création
d'une ambassade commune à Ulan Bator et d'un institut culturel
germano-franco-polonais à Varsovie ; nous attendons encore avec
avidité ne serait-ce que leur simple apparition. N'aurait-il
pas été plus conséquent, par respect vis-à-vis de la coopération
conjointe avec la Pologne, de fonder enfin l'institut culturel
de Varsovie, et d'y joindre immédiatement une ambassade commune
? Dans le contexte de l'élargissement à l'Est de l'Union européenne,
cette initiative aurait été d'une portée beaucoup plus que symbolique.
On trouve également, au compte des nouvelles déclarations, le
projet d'instituer "un Secrétaire général pour la coopération
franco-allemande dans chaque pays. Personnalité de haut niveau,
il sera rattaché personnellement au Chancelier et au Premier
ministre et disposera d'une structure appropriée au ministère
des Affaires étrangères. (...) Il sera assisté d'un adjoint
du pays partenaire". (Article 41) L'observateur averti se
demande franchement ce qui peut bien faire la différence entre
ce Secrétaire général et le déjà existant "Coordonnateur pour
la coopération franco-allemande", en place depuis plusieurs
décennies et rattaché au ministère des Affaires étrangères.
Le transfert des compétences du ministère des Affaires étrangères
au Chancelier et au Premier ministre est-il à tel point significatif
qu'il faille pour cela créer une nouvelle charge ? Et qu'advient-il
du Coordonnateur déjà en place qui était lui aussi, faut-il
le rappeler, "une personnalité de haut niveau" ? Aurons-nous
affaire dans l'avenir à six délégués /représentants intérimaires
/coordonnateurs ? Peut-on sérieusement s'attendre à ce que la
coopération franco-allemande s'en porte mieux si une nouvelle
charge est instituée à l'occasion de chaque jubilée ?
Une autre nouveauté est la proposition de "permettre à nos
ressortissants de bénéficier, s'ils le souhaitent, de la nationalité
de nos deux pays." (Article 22) Cette possibilité était-elle
jusqu'ici inexistante ? Les nombreux citoyens déjà en possession
des deux passeports n'étaient-ils donc que de vulgaires "illégaux"
? Ou faut-il plutôt comprendre que chacun dont le cœur et l'esprit
sont gagnés au pays voisin peut demander, pour ainsi dire au
sens symbolique, la nationalité du pays partenaire ? Ce serait
déjà bien, et il faudrait prendre cette proposition au pied
de la lettre. Néanmoins il serait encore plus important de favoriser
les infrastructures indispensables à la poursuite d'un tel développement.
Autrement dit, chaque Allemand et chaque Français devrait pouvoir
faire reconnaître ses diplômes scolaires et professionnels dans
le pays voisin, exactement comme s'il était dans son propre
pays. Faut-il mentionner ici qu'Américains et Canadiens, qui
n'ont pourtant aucune "Union européenne", disposent de cette
possibilité depuis longtemps ? Quelle révolution aurait-on là
dans le chaos des équivalences et de la bureaucratie franco-allemandes,
et ce déjà sans nationalité commune ! Ce cadre unique pour l'éducation
et la profession, tel que souhaité à l'article 17, deviendrait
sur le champ une réalité plausible.
La Déclaration commune est farcie d'annonces et de propositions
concrètes destinées avant tout à satisfaire les besoins du public,
nées sous la pression manifeste qu'exerce la tenue d'une commémoration
officielle. Toutefois la lecture de ce long document, plus long
en fait que l'historique Traité de l'Élysée lui-même, rend perplexe
jusqu'à en couper le souffle. Plus court aurait été préférable,
plus court aurait offert davantage ; ce fut jadis la clef du
succès du Traité de l'Élysée. Les gouvernements des deux États
auraient été mieux avisés d'émettre une très brève déclaration
le 22 janvier dernier. Et ils auraient du se donner la peine
de rappeler, portant cérémonieusement à réfléchir, que le Traité
de l'Élysée, conclu il y a quarante ans entre l'Allemagne de
l'Ouest et la France, s'applique désormais depuis douze ans
à l'ensemble du peuple allemand. Au demeurant, ce nouvel état
de fait, quant à lui véritablement historique, ne se voit apprécié
dans aucun des discours officiels prononcés à l'occasion du
22 janvier. Continuant de s'exprimer en ce sens, les deux gouvernements
auraient pu en profiter pour enfin donner corps sans plus attendre
à toutes les déclarations et ententes publiées depuis la signature
de l'Accord culturel franco-allemand du 23 octobre 1954, qui
emplissent aujourd'hui un livre entier, et pour renforcer les
institutions déjà existantes. On pourrait laisser tout le reste
aux modalités d'application, mais le citoyen aurait une prétention
légitime au respect de toutes les promesses engagées.
Bref, la coopération franco-allemande tombe à son tour sous
le joug douteux des usages et convenances, typiques de cette
"société du spectacle" à laquelle appartient désormais notre
grisaille quotidienne. De cette façon, elle passe à la "normalité"
(faut-il comprendre à la banalité ?), dans une dimension autre
que celle où l'entendait le Président fédéral Johannes Rau.
La "journée franco-allemande" prévue tous les ans le 22 janvier,
fraîchement instituée à l'article 16 de la déclaration commune,
doit-elle tout autant relever de cette morosité ? Aurons-nous
dès ce jour le bonheur, nous les amis de la France, d'assister
impuissants, tous les 22 janvier, à d'éternelles professions
et déclarations d'intention sans cesse renouvelées, pour la
concrétisation desquelles nous attendrons encore, malheureusement,
en vain ? Un haut fonctionnaire joliment perché dans son ministère
nous offrait déjà toute fraîche la soi-disant consolation idéale
: "De quoi vous irritez-vous ? Nous n'avons absolument aucune
obligation d'accomplir ces recommandations."
Dresde, le 2 février 2003 |
|
© Tous droits de
reproduction réservés
 |

